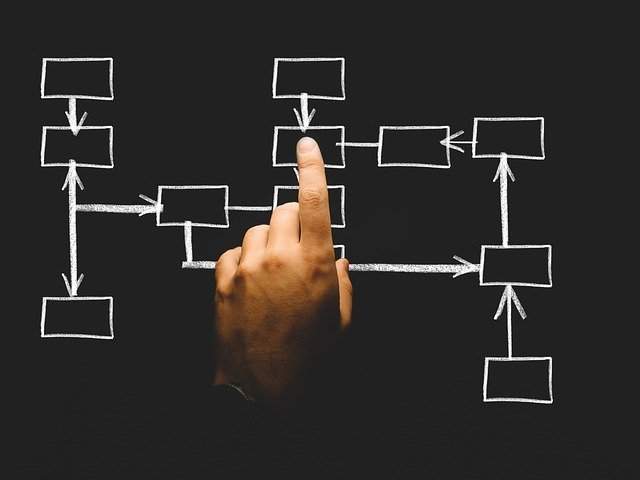Comment concilier l’entreprise hyper connectée et les modes de management à l’ancienne ? Il ne s’agit pas, ou plus, de multiplier les réorganisations et les projets de changement ou de transformation mais, au contraire, de réconcilier les trois dynamiques de toute organisation : celle qui produit, celle qui vend et celle qui innove.
« Le manager qui réitère ad nauseum les approches straté-giques et managériales classiques, précisément celles qui l’ont attiré dans une situation difficile, est assuré de ne pas réussir », assène l’auteur de cet ouvrage, Daniel Martin-Gelot, président de la société de conseil Arial, qui suggère de « sortir du cadre. »
C’est notamment pertinent lorsque les managers sont confrontés à des situations difficiles, voire a priori inextricables, et à une injonction contradictoire : « Nombre de managers se trouvent propulsés en terre inconnue, dans un terrain vague managérial où soi-disant tout est possible, mais rien n’est permis. Dans ce contexte à haut risque, les bibles du management sont d’un secours aussi relatif que le bréviaire d’un missionnaire face aux guerriers cannibales », ajoute l’auteur.
La plupart des managers réagissent, soit en se résignant « à couler avec le navire », soit en s’abritant « derrière les hautes murailles des firmes prestigieuses du conseil ou de la technologie, lesquelles semblent assumer depuis longtemps, dilué dans un nombre raisonnable de succès, un nombre significatif d’échecs que nul ne saurait reprocher à leurs clients. »
Les théories du management sont-elles ringardes ?
Le décalage entre les théories managériales et la réalité s’explique de plusieurs manières. D’abord, parce que les courants de pensée qui les ont engendrées sont trop marqués historiquement. Pour l’auteur, « toutes ces théories sont des matrices : elles induisent des représentations et des systèmes de pensée datés ». D’autant que la complexité des organisations et des processus n’a rien arrangé, bien au contraire : « Ficelés, corsetés dans des procédures censées apporter de l’efficacité, nous feignons tous de croire que nous maîtrisons nos fondamentaux », ajoute l’auteur, qui suggère de « débrancher les automatismes de la pensée managériale. »
Repenser le management, une urgence à l’ère numérique, par Daniel Martin-Gelot, Ed. Maxima, 2015, 174 pages.
Ensuite, le décalage s’explique par le fait que les théories managériales classiques sont destinées à un monde en croissance : « Dans ce contexte, tout ce que l’on pouvait inventer de rationnel en termes managériaux n’était pas toujours efficient, mais toujours efficace, avalé dans l’accélération des flux ou la valorisation inflationniste des stocks », précise l’auteur. La célèbre matrice du Boston Consulting Group est révélatrice de cette approche, elle s’applique à des marchés en forte croissance et a perdu une partie de son intérêt. Enfin, les approches managériales traditionnelles sont mises à mal par le numérique, qui a raccourci à la fois le temps et l’espace.
Daniel Martin-Gelot prône un management organique. À l’image de la croissance organique, qui ne se base que sur les ressources propres de l’entreprise, le management organique s’appuie sur les forces déjà existantes dans l’entreprise. L’auteur en identifie six : la force du courant, la force des individus, la force du leader, la force du cœur de métier, la force du terrain et celle du système.
L’entreprise, accélératrice de flux
La force du courant consiste avant tout à accélérer les flux, par opposition à la fonction historique de l’entreprise basée sur la gestion de stocks. « Il n’y a pas de croissance sans accélération des flux », note l’auteur, pour qui le moindre stock fait obstacle aux flux : « Il en va des produits comme des idées, des flux financiers comme des flux commerciaux, des organigrammes comme des trajectoires humaines : moins il y a d’inertie, moins il y a de frottements, mieux les flux circuleront et plus l’entreprise créera de la valeur. »
Cela suppose de chercher à se développer plutôt que de réduire les coûts, ce qui peut intervenir dans un second temps. « Si on commence à travailler sur les coûts, on met tout le monde à l’arrêt, alors qu’avec des perspectives nouvelles, tout le monde sera tenté de lâcher prise », assure l’auteur. Mais il faut d’abord se débarrasser des barrages dressés par les managers ou les opérationnels : « Comme les castors, ils construisent et entretiennent quantités de petits obstacles qui se placent en travers des flux. Ces petits barrages les protègent. »
La force des individus repose sur un constat : ceux-ci n’agissent dans l’organisation qu’en fonction de leur propre intérêt, qui fixe des règles de conduite. Résultat : « L’idée de faire travailler les individus en collectif, en mode organisé et conduit, est une illusion absolue. Évidemment, cela n’arrange personne de le reconnaître, le déni est majoritaire et agréablement anesthésiant », soutient l’auteur. Il est néanmoins possible d’agir : « L’individu n’est influençable que sur un temps très court, tout l’art du management consiste à intervenir à ces endroits charnières. »
Parler moins, incarner plus
La force du leader consiste à incarner l’entreprise… et à produire d’autres leaders ! « Le leader émerge d’un contexte, d’une situation, parce qu’il incarne des principes sur lesquels une majorité a fini par se projeter. Pour cela, il lui a fallu se préparer bien en amont de la situation qui a favorisé son émergence. » Le manager-leader doit ainsi « parler moins pour incarner plus », en acceptant de challenger sa vision. « Ce renouvellement vivifiant de la vision est primordial, il s’appuie sur l’écoute et l’explication des contributions de terrain, suivant des flux de communication qui doivent circuler dans les deux sens. »
La force du cœur de métier est l’ADN d’une entreprise, il doit être aligné avec ses savoir-faire, les deux sont interdépendants. Pour l’auteur, « le cœur de métier stratégique est le repère central qui permet d’arbitrer toutes les décisions. Attaqué en permanence par un brouillard de décisions disperses et dispersantes, il appelle à un effort de cohérence et à un renforcement régulier de sa structure. Faute de quoi, de déviances en dégénérescences, l’entreprise court à sa perte, à l’heure industrielle comme à l’heure numérique. »
80 % de réalité, 20 % de croyances
La force du terrain consiste à miser sur le réel et non sur ses représentations : « L’absence totale d’a priori et de croyances est, bien sûr, utopique, souligne l’auteur, viser 80 % de perception du réel et laisser 20 % aux systèmes de croyances seraient un objectif raisonnable, malheureusement, c’est l’inverse qui prévaut. » Utiliser la force du terrain suppose de savoir repérer les signaux faibles.
Enfin, la force du système consiste à ne pas surmanager, ce qui est souvent le cas dans les organisations pyramidales, qui assurent à la fois la collecte de l’information (plutôt au sommet de la pyramide) et la prise de décision. Ce système est de plus en plus contesté, notamment avec le Shadow IT et les outils technologiques, qui multiplient les interactions hors de la sphère professionnelle.
De fait, la pyramide de la décision se trouve dissociée de la pyramide de l’information : « Le réel est dans l’angle mort de la pyramide bureaucratique », assure l’auteur, pour qui, aujourd’hui, « la création de valeur repose sur une chaîne d’engagements horizontale, les actions managériales verticales ne font que la perturber », chacun restant dans sa sphère de responsabilités. Pire : « Une tentation fréquente, qui a évidemment la faveur des cabinets d’organisation, est de détailler ces processus transverses. Le remède est pire que le mal : plus ils sont précis, plus ils figent l’entreprise sur un modèle procédurier, incapable de réactivité, tout élan transversal est tué dans l’œuf. »
Et dès qu’une entreprise atteint une certaine taille, on retrouve les organisations pyramidales. En réalité, la performance des organisations accélératrices de flux repose sur les interactions entre des sous-ensembles. « La réalité se configure aux frontières de l’entreprise, l’équilibre des échanges se joue entre des petits groupes homogènes, contraints ou soudés par un intérêt commun », résume l’auteur.
D’où la nécessité, pour les managers, de rester connectés au terrain : « Un leader qui ne l’est pas en permanence ne saura rien des débuts des dérives, ni des moments où il serait judicieux d’influencer les parcours. Le management, c’est l’orchestration de deux dynamiques inséparables : celle qui produit et celle qui innove. »
Sans oublier un indispensable effort de créativité, parent pauvre des entreprises. « Il a toujours été considéré qu’on pouvait s’en sortir avec des trains de projets : d’entreprise, de changement ou de management participatif. Évidemment, « ça imprime peu » dans l’entreprise, en dehors de créer de la frustration et du stress. »
Daniel Martin-Gelot suggère aux managers de piloter par la « pénurie positive ». Le principe consiste à amener les responsables de projet dans une zone inconfortable en termes de budgets et de délais, de manière à ce qu’ils trouvent leurs propres moyens de réussir face à des contraintes fortes. Et quand ce n’est pas ou plus possible, cela oblige à renégocier les conditions initiales.
Pour l’auteur, une telle approche, plutôt ambitieuse, produit deux effets : d’une part, « un alignement immédiat sur le sens, qui se diffuse alors jusqu’aux acteurs les plus opérationnels. » D’autre part, « la contrainte fait émerger des leviers là où ils sont les plus efficaces, où ils ont le plus grand potentiel de réussite. »