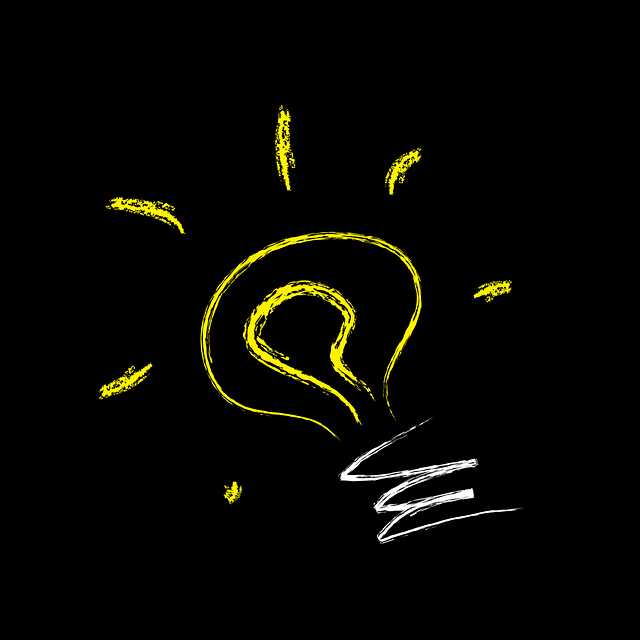Claude Roche, ingénieur et docteur en philosophie, spécialiste dans l’économie de l’immatériel, et Joanna Pomian, docteur en informatique, spécialiste de l’organisation et de la stratégie des entreprises, ont co-écrit l’ouvrage « Connaissance capitale, management des connaissances et organisation du travail », publié aux Editions Sapienta/L’Harmattan. Ils nous expliquent comment la connaissance crée de la valeur.
Pourquoi, aujourd’hui, parle-t-on tant du management des connaissances ?
J.P. et C.R. Depuis le milieu du XXème siècle, trois tendances convergentes sont à l’œuvre pour modifier le lieu où se produit la valeur de l’entreprise. Le premier mouvement concerne le rythme de renouvellement des produits, qui supplante progressivement la forme concurrentielle classique, par les prix. D’où un déplacement du centre de gravité de création de valeur. En termes économiques, on mise ainsi sur une valorisation d’une rente, plutôt que sur celle du produit. Le lieu de création de valeur se déplace du lieu de production vers le lieu de conception, avec une importance particulière pour la recherche-développement, le marketing et « l’écoute client ».
Seconde tendance : la pénétration de la logique économique dans l’univers tertiaire. Le secteur des télécoms est particulièrement significatif : embryonnaire il y a un demi-siècle, lié à un monopole politique de l’Etat, ce secteur s’est considérablement développé, avec une polarisation croissante des opérateurs sur la fonction sociale de relation et d’information plutôt que sur les moyens techniques l’autorisant. La création de valeur devient donc immatérielle, basée sur le transfert d’informations, de dialogue, voire de la production directe de connaissances, comme dans le cas des activités de formation. Enfin, la troisième tendance concerne la logique générale de l’informatisation, notamment dans le secteur tertiaire. Ces trois tendances se combinent en renforçant leurs effets, avec plusieurs conséquences. D’abord une intellectualisation du travail, une dématérialisation du travail autour d’activités relationnelles, d’échanges d’informations. Ensuite, la servicialisation de l’économie, qui bouleverse les modes d’organisation des entreprises en relation avec leur clientèle, même si ni le produit, ni le contrat ne vont disparaître d’un trait du champ de l’économie. On observe enfin une dématérialisation du capital, dont l’évaluation reste difficile. Cette dématérialisation implique une série d’interrogations sur le processus de connaissance.
Comment définissez vous la connaissance ?
J.P. et C.R. La question de la connaissance renvoie à celle de sa validité, et même de sa vérité. Connaître a toujours signifié, dans la culture occidentale, « tenir pour vrai ». Que la connaissance doive être utile à l’entreprise ne l’exonère pas de tout rapport à la réalité, bien au contraire. Cette utilité renvoie à deux critères spécifiques : il s’agit, d’abord, d’une connaissance relative, au sens de relatif à un savoir extérieur, car l’entreprise ne cherche jamais la connaissance en soi. Ainsi, connaître en entreprise suppose de se situer par rapport à un champ de connaissances déjà balisé, par exemple les sciences ou le droit. Ensuite, la connaissance doit être pertinente, c’est-à-dire adéquate par rapport à un problème posé. Pour la philosophie classique, la connaissance se construit dans un rapport privilégié entre un sujet « connaissant » et son objet.
En quoi ce concept de connaissance se distingue-t-il des notions d’information, de fait ou de donnée ?
J.P. et C.R. Une donnée est un élément ponctuel, sans autre signification qu’elle même : une date, une mesure ou une somme à payer constituent des exemples de données. Mais la donnée apporte peu d’enseignements sur les phénomènes qu’elle traduit de façon brute. Un fait est un phénomène qui a été effectivement constaté et/ou mesuré. Quant à l’information, c’est un élément supérieur dans la triade : donnée/information/connaissance. D’un point de vue étymologique, l’information est un ensemble de données mises en forme, présentées de manière à être davantage signifiantes que les données seules. Une information relie certains faits ou événements. La connaissance, dans le contexte de l’entreprise, apparaît d’abord comme de l’information qui a été finalisée, contextualisée et qui doit servir à l’action, quelle que soit la manière dont on l’envisage (action mentale ou physique). L’origine de presque toute la connaissance en entreprise réside dans son environnement, c’est-à-dire dans l’expérience que l’entreprise aura de ses contacts avec la réalité des objets qu’elle travaille ainsi que de la réalité humaine du marché avec qui elle commerce.
Comment se crée la connaissance dans une organisation ?
J.P. et C.R. Nous pensons que la connaissance dans l’organisation se crée au cours « d’épreuves », qui sont des situations au cours desquelles on ne peut pas reconduire à l’identique une solution existante, à l’image, par exemple, de l’élaboration d’un nouveau process de travail. On doit donc trouver une nouvelle solution. Pour cela, on a besoin de connaissances. La notion d’épreuve conduit à privilégier un point de vue dynamique sur les connaissances. En effet, l’épreuve constitue le carrefour d’un important flux de connaissances. Plus il est difficile d’accéder aux connaissances nécessaires pour franchir l’épreuve, plus celle-ci sera pénible, voire porteuse de risque. On trouve des épreuves dans des domaines très divers, liés à la technique (rechercher des nouvelles technologies, des processus), à l’organisation (choix des fournisseurs, les plannings et les coûts des projets), ou aux acteurs (collaboration entre les métiers et les individus, dans et hors de l’entreprise par exemple). Dire que l’expérience et l’expertise dans l’entreprise, autrement dit les connaissances, se forgent au cours des épreuves, c’est s’inscrire dans le droit fil des sources latines du terme « expert », qui renvoie à « expérience », donc « épreuve ». C’est pourquoi l’épreuve n’est pas une notion négative : c’est le lot quotidien des entreprises. Les solutions de non-reconduction automatique des solutions existantes y souvent plus nombreuses que celles au cours desquelles ont agit sans réfléchir.
CIO. Les entreprises et organisations trop bureaucratiques peuvent-elles être créatrices de connaissances ?
J.P. et C.R. L’abus de procédures paralyse généralement le système et tue la créativité. Le danger est de toujours suivre la procédure, même si elle est débile. Le problème des organisation très hiérarchiques est qu’elles empêchent la communication transversale. Il ne se produit donc pas d’échanges de connaissances. Par exemple, dans de telles organisations, l’usage de l’e-mail est peu répandu, réservé aux chefs ou présent uniquement avec des adresses collectives.
Le champ de la connaissance n’est-il pas marqué par une surproduction qui paralyse les entreprises ?
J.P. et C.R. La communication professionnelle est dominée par l’écrit. L’usage des intranets et des outils de communication va accentuer cette tendance. Il a certes été affirmé que les messageries auraient pour effet de généraliser les caractéristiques de l’oral à la communication écrite : il n’en est rien, en témoignent les chartes d’usages des messageries qui poussent à la précision, au formalisme et à la lisibilité plutôt qu’à la réactivité. La communication est également extérieure au manager. L’arrivé de la messagerie dans un grand groupe pharmaceutique, il y a quelques années, a provoqué une révolte de certains managers, inquiets de ne plus savoir ce que savaient leurs collaborateurs. Ils ont demandé à être systématiquement en copie de tous les messages reçus par leurs subordonnées. Submergés, ils ont évidemment fait machine arrière ! Il est incontestable que les individus sont désormais confrontés à une quantité telle d’informations qu’ils ont des difficultés réelles à les gérer, à les assimiler. C’est un phénomène assez récent mais massif. Aussi peut-on noter dans les équipes projet un réel phénomène de repli sur les enjeux de court terme car les acteurs « n’ont plus le temps de s’interroger sur les interfaces ». De même, il n’est plus rare de voir le rendez-vous quotidien se généraliser au-delà des seuls cadres et experts. Ce phénomène pose un problème d’efficacité globale à l’entreprise.
En quoi le système d’information, et particulièrement le DSI, joue-t-il un rôle, notamment vis-à-vis des outils de gestion de la connaissance ?
J.P. et C.R. Le DSI est évidemment l’épine dorsale de l’entreprise. Il doit être associé, de manière à ce qu’il ne découvre pas à la dernière minute les projets initiés par la direction générale. Certains informaticiens ne comprennent pas les enjeux ou, lorsqu’ils les comprennent, prennent peur, mais le DSI, lui, comprend parfaitement ces enjeux, même si une partie significative des initiatives que nous observons se résume à la mise en place d’outils informatisés. Or, les véritables enjeux du management des connaissances dépassent largement cette question des outils et le terme très répandu de Knowledge management n’est souvent qu’un habillage marketing pour vendre plus de produits. Non pas que les fonctions de ces outils soient en cause, mais beaucoup d’entreprises achètent des logiciels comme une fin en soi. Il n’est pas pensable qu’une entreprise avance en se passant de tels outils, mais les exemples d’outils sous utilisés et de promesses déçues sont légion.
Les systèmes d’information sont-ils suffisamment souples pour intégrer cette problématique de management des connaissances ?
J.P. et C.R. J.P. et C.R On observe un manque de souplesse des systèmes d’information vis-à-vis des nouveaux outils de communication s’explique, d’une part, par une incohérence structurelle entre les divers applicatifs. Cette difficulté est au cœur des préoccupations des maîtrises d’ouvrage. Elle explique que les directions informatiques soient en général polarisées sur un contrôle très strict des évolutions fonctionnelles, notamment après l’échec des projets, que l’on a qualifié de pharaoniques, de refonte globale des systèmes d’information. C’est ce besoin de contrôle, dont la résorption est l’enjeu des travaux d’urbanisation qui explique la longue réticence des DSI à toute idée de système d’information souple… et les succès récurrents des PGI ! D’autre part, on observe une mauvaise orientation « logique » des données, dont le référentiel a été construit d’un point de vue interne à l’entreprise et se traduit par un éclatement de la vision de l’environnement de l’entreprises donnée par le système d’information. Cela signifie que les données n’ont pas la même signification pour deux acteurs différents et donc pour le système d’information. C’est de cette ambiguïté que sont nés les outils de CRM, dont le projet est de réunifier la vision « informatique » d’un client à partir de ces informations éclatées.
Ces difficultés sont-elles insurmontables ?
J.P. et C.R. Non, elles pourraient être en partie levées, et même facilement, en s’appuyant sur des outils plus souples comme les outils de communication en réseau : les worflows, par exemple, constituent de puissants outils de transversalité. Et la souplesse de leur usage a pour effet, à terme, de renforcer la cohésion interne des applicatifs qui leur sont liés. Quant aux outils collaboratifs, il est clair qu’ils pourraient aisément soutenir la logique CRM, par exemple pour structurer un débat entre plusieurs acteurs concernés par un même objet, un client par exemple. Néanmoins, force est de constater que les directions des systèmes d’information ont été plutôt réticentes face à l’utilisation de ces nouveaux outils. Une résistance plus larvée qu’affirmée car on a créé assez souvent des structures dédiées aux « outils bureautiques » dans les grandes directions informatiques, mais sans grand budget et pouvoirs. Les années passées ont ainsi été marquées par une extrême difficulté d’intégrer des logiques de partage des connaissances. Hélas, la difficulté, en matière de management des connaissances, est qu’il n’existe pas de modèles types de conduite de projets.