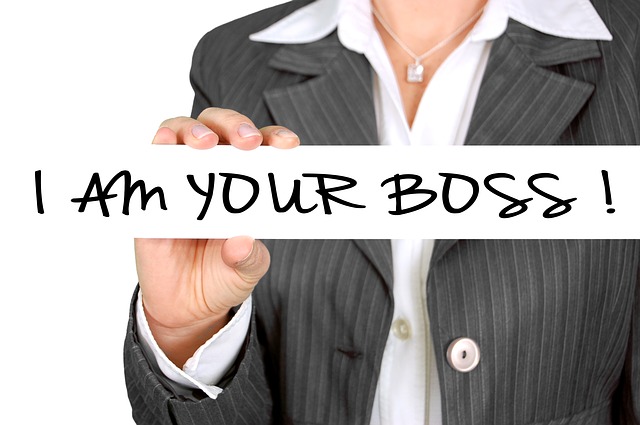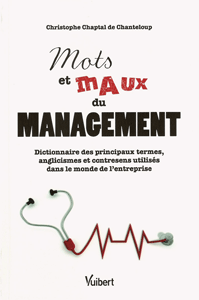De contresens en anglicismes, les entreprises souffrent d’un mal profond : les managers se prennent trop souvent très au sérieux. Au point d’employer des mots et des expressions qui ne veulent rien dire. Ce petit dictionnaire écrit par Christophe Chaptal de Chanteloup nous éclaire d’une façon humoristique sur tous ces travers qui minent la vie au bureau.
« On est passé du langage quasi militaire (on donne un ordre clair et précis), nous explique l’auteur, à une langue délicate, emplie de codes et de sens au second degré, dont la subtilité et l’apparente finesse ne doivent pourtant jamais faire oublier que les rapports hiérarchiques sont, qu’on le veuille ou non, à la base du fonctionnement quotidien. »
Cet ouvrage a le mérite de faire réfléchir à la vraie signification des termes et milite pour davantage de simplicité, selon le principe que ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement.
Les DSI consomment beaucoup de chefs de projets qui, dans ce dictionnaire, n’ont pas le beau rôle : « Le chef de projet est un kamikaze des temps modernes : sacrifié par sa hiérarchie, méprisé par ses collègues, honni par ses équipes, détesté par les fournisseurs, c’est à lui que revient de mener à bien un projet hautement stratégique pour lequel ni les objectifs à atteindre ni les moyens alloués ne paraissent décrits avec la nécessaire transparence qu’on s’attendrait à y trouver », explique l’auteur.
Mots et maux du management, par Christophe Chaptal de Chanteloup, Éditions Vuibert, 2011, 125 pages.
Pire : lorsque le chef de projet échoue, « configuration fréquente », précise l’auteur, « le chef de projet est toujours relégué à un poste inutile dans lequel, faute d’activité, il sombre inexorablement dans une longue et douloureuse dépression ». Certes, on peut toujours pratiquer l’audit et le benchmarking à outrance.
L’audit est ainsi caractérisé par le principe suivant : « Faire ausculter un certain nombre de processus dont l’utilité n’est pas clairement définie, par une armée de consultants juniors qui n’ont pas toujours les clés opérationnelles pour les comprendre. » Le benchmarking, lui, s’utilise essentiellement pour plagier ce que font les concurrents : « C’est ce qui permet aux équipes de dire : « Grâce au benchmark, on n’est pas meilleur que les autres, mais on n’est pas plus mauvais. » »
Pour ceux qui vont bientôt préparer leurs budgets, l’auteur explique que cet exercice « rituel » constitue une « tentative de construction d’une projection chiffrée, dont l’irréalisme se pare d’une présentation sobre mais attractive dont la logique interne importe davantage que la cohérence globale ». Et, de fait, on est toujours « en dessous » du budget, ou « au-dessus », mais jamais « en dedans ».
Un manager se doit bien sûr d’être aligné métier. Ou, pour parler moderne, « Business oriented ». Ce qui est la moindre des choses, assure l’auteur : « À moins que certains n’aient en tête qu’il puisse exister des configurations intéressantes, où il serait d’usage d’être, comment dire, business-desoriented ? »
On peut être bien disposé face à « quelqu’un de confiance » ou à « quelqu’un de bien ». Mais le premier est soit « une personne dont la moralité impeccable lui permet de durablement mériter la confiance de ses supérieurs », soit « un être amoral et entièrement dévoué à l’entreprise acceptant servilement de compromettre un collaborateur honnête ». Le second est souvent un « naïf qu’on peut charger de tâches ignobles », ou bien « le fâcheux qui dit une vérité que personne ne souhaite entendre : dans les deux cas, il serait criminel de faire confiance à celui ou celle qu’on affuble de ce qualificatif ».
Côté comité de direction, ce n’est pas mieux : « Il ressemble parfois à une représentation quasi théâtrale, durant laquelle des personnages à l’ego bien dimensionné se livrent à des joutes oratoires sur des sujets dont l’importance est inversement proportionnelle aux efforts dialectiques mise en œuvre. » Et inutile de compter sur une bonne gestion du changement pour s’en sortir.
Pour l’auteur, « si le changement était un véhicule, il serait le plus souvent doté d’un moteur sous-dimensionné, mais fortement énergivore, d’une tenue de route déficiente, d’un confort spartiate et d’une visibilité réduite ». Hélas, dans beaucoup d’entreprises, ce redoutable chantier de conduite du changement est confiée à des « spécialistes dont l’esprit aventureux n’a d’égal que la longue pratique des engins motorisés peu fiables et par conséquent dangereux ».
On appréciera particulièrement la définition de la bonne pratique, qui se repère avec trois indices : « Elle est compréhensible aisément, même par celui dont le QI avoisine la température arctique ; elle donne un résultat relativement tangible quoique évident, par exemple, éteindre la lumière diminue la consommation énergétique ; elle est théoriquement facile à mettre en œuvre, même si en réalité il en va différemment. »