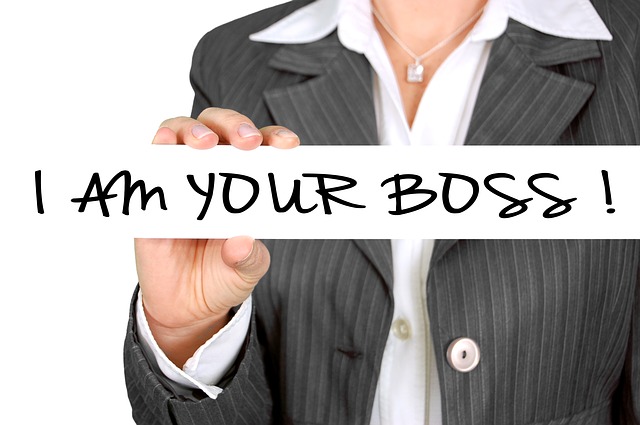Le principe de l’amélioration continue est largement reconnu et accepté par les entreprises. Hélas, dans la réalité, les organisations n’apprennent pas de leurs erreurs. Plusieurs raisons expliquent ce décalage. Quatre biais sont en particulier dévastateurs pour l’amélioration continue. Pourquoi les entreprises ne capitalisent-elles pas suffisamment sur leurs erreurs passées ?
À l’heure où l’amélioration continue devient un standard dans les bonnes pratiques pour gérer n’importe quel projet et capitaliser pour le futur, il est paradoxal de constater que, sur le terrain, tout ne se passe pas comme prévu. Deux universitaires américains, Francesca Gino (Harvard Business School) et Bradley Staats (université de Caroline du nord) expliquent cette situation par quatre biais qui touchent toutes les organisations.
1. Le biais lié au succès : la peur de l’échec
Deux attitudes sont significatives : d’une part, la peur de l’échec, parce que cette perspective « crée de l’angoisse, de la colère, de la honte, voire favorise des états dépressifs », soulignent les auteurs, « la plupart des individus cherchent à éviter les erreurs ou, lorsqu’elles se produisent, à les « cacher sous le tapis ». » D’autant, ajoutent les auteurs, que « les directions générales ont, souvent inconsciemment, institutionnalisé cette peur de l’échec. De fait, il n’y a pas de budget ni de temps pour expérimenter et les bonus dépendent du suivi du plan établi. »
D’autre part, l’attitude à l’égard du succès. Les auteurs distinguent une attitude déterministe et une autre dite « d’ouverture » (growth mindset). La première se base sur l’idée que l’intelligence et le talent sont avant tout une affaire de génétique : certains en ont, d’autres pas.
« Les individus qui privilégient cette attitude ne veulent pas échouer, de peur de paraître incompétents, cela limite leur capacité à apprendre parce qu’ils se focalisent trop sur la performance à atteindre. » La seconde pose que les individus recherchent des challenges et des opportunités d’apprendre et ils sont persuadés que l’on peut toujours s’améliorer.
« Why Organizations Don’t Learn », par Francesca Gino et Bradley Staats, Harvard Business Review, novembre 2015.
Il existe également, rappellent les auteurs, une confiance affirmée sur les performances passées, par rapport au potentiel d’apprentissage, ainsi qu’un biais d’attribution : « Les individus, lorsqu’ils réussissent, attribuent leur succès à leur capacité de travail et à leur talent, et lorsqu’ils échouent, ils tendent à invoquer la malchance ; mais tant que les individus ne reconnaissent pas que leurs échecs sont dûs à leurs actions, ils ne peuvent progresser en apprenant. »
Pour éviter ce biais, les auteurs suggèrent quatre bonnes pratiques : déstigmatiser l’échec en prônant ses vertus pédagogiques, transformer l’état d’esprit et la culture d’entreprise pour intégrer l’apprentissage continu, revoir les critères de recrutement et utiliser l’analyse de données pour mieux identifier les causes d’échec et de réussite.
2. Le biais lié à l’action : agir d’abord, réfléchir après
Ce phénomène se traduit par une suractivité alors que l’inaction pourrait être bonne conseillère. « Comment réagissez-vous lorsque surviennent des difficultés dans votre entreprise ? Comme la plupart des managers, vous optez pour l’action, en travaillant plus et en augmentant votre niveau de stress. Il est rassurant d’agir, même si c’est contre-productif et si ne rien faire pourrait s’avérer être la bonne solution », détaillent les auteurs.
Ceux-ci font un parallèle avec les gardiens de but : la probabilité d’arrêter le ballon tiré par l’adversaire est équivalente (soit 33,3 %) selon que le gardien reste au centre de la cage, plonge à droite ou plonge à gauche. Pourtant, 93 % des gardiens de but choisissent de plonger à droite ou à gauche. Pourquoi ? « Parce qu’il est plus valorisant de rater l’arrêt de la balle si l’on a agi que si l’on reste sans rien faire », expliquent les auteurs, qui rappellent que cette aversion à l’inaction est courante dans le monde professionnel.
Pour sortir de ce biais, les auteurs suggèrent de combattre trois maux : d’abord, l’épuisement des individus qui aboutit à ce qu’ils n’aient plus envie d’apprendre de nouvelles choses ou d’approfondir ce qu’ils connaissent déjà. Ensuite, le manque de réflexion, parce que les individus sont toujours sous tension. Une expérience, relatée par les auteurs et menée chez Wipro, est à cet égard instructive.
Dans le cadre d’un programme de formation, deux groupes ont été constitués : le premier a consacré quinze minutes, à la fin de chaque journée, à réfléchir et à écrire sur les apports de la formation. Le second groupe a continué à travailler pendant ces quinze minutes. Résultat : le premier groupe a eu des résultats, à l’issue de la formation, supérieurs de 20 % à ceux obtenus par le second groupe.
Enfin, il convient d’introduire des ruptures dans les agendas : « Les managers doivent expérimenter, puisqu’il n’y a pas de règle générale, pour identifier le nombre de ruptures et leurs durées, en lien avec les individus qui, eux aussi, savent quand ils doivent faire une pause », précisent les auteurs. Cela permet de prendre le temps de réfléchir, notamment après l’action.
« De même que l’on bloque des plages horaires dans son agenda pour agir, il faut pouvoir bloquer son agenda pour tirer le bilan de ses actions, à l’image des retours d’expérience systématiques chez les militaires et ne pas perdre de vue l’objectif : apprendre en imaginant commet on aurait pu procéder autrement », suggèrent les auteurs.
3. Le biais de conformité : le respect des règles d’abord
Deux comportements favorisent ce biais de conformité. D’une part, croire qu’il est nécessaire de toujours se conformer à des règles et normes sociales ou organisationnelles. « Nous passons donc beaucoup de temps à apprendre ces règles, écrites ou non écrites, qui régissent la vie au travail », notent les auteurs.
Une recherche a montré que le fait de s’habiller de manière non conformiste ou, dans une réunion, d’utiliser son propre fond graphique de Powerpoint au lieu de celui imposé par l’entreprise, modifie, dans le bon sens, la perception des compétences et du statut de ceux qui ne se conforment pas aux règles établies.
D’autre part, les individus éprouvent des difficultés à capitaliser sur leurs forces : « Lorsque les individus se conforment aux règles de l’entreprise, ils sont moins enclins à être eux-mêmes et à s’appuyer sur leurs forces et qualités », soulignent les auteurs, qui suggèrent de travailler sur la notion « d’engagement » des individus.
4. Le biais lié aux experts : une vision trop étriquée
Les experts représentent-ils les meilleures sources pour s’améliorer ? C’est la base de toutes les théories du management et de l’évangélisation des organisations par les bonnes pratiques. Le recours à des consultants perdure dans la plupart des entreprises. Mais, selon les auteurs, cela introduit deux distorsions. D’une part, les entreprises perçoivent l’expert avec une vision trop étroite, en se basant sur des indicateurs tels que ses diplômes ou ses années d’expérience, alors que d’autres critères sont tout aussi déterminants.
Entre un expert qui, bardé de diplômes, affiche vingt ans d’expérience, mais qui ne s’est guère confronté au terrain, et un autre, plus jeune, moins diplômé, mais qui a été immergé très tôt dans des problèmes concrets, il faudrait plutôt privilégier l’expertise du second. « L’expérience se construit de façon multidimensionnelle », rappellent les auteurs.
D’autre part, ceux qui sont les plus à même de résoudre les problèmes adressés à des consultants et à des experts, en l’occurrence les collaborateurs en lien direct avec les clients ou ceux en charge du back office, sont rarement impliqués et invités à donner leur avis. « Ce sont souvent les seules recommandations des experts qui sont mises en œuvre », déplorent les auteurs.
Ils recommandent deux actions : encourager les individus à résoudre eux-mêmes les problèmes auxquels ils sont confrontés, grâce à leur propre expertise, et proposer aux collaborateurs différents types d’expériences, surtout à ceux qui font des tâches répétitives.
Prise de décision : comment éviter de se tromper
Les consultants de McKinsey ont établi une check-list de la prise de décision, qui permet de limiter les biais, en se posant six questions :
- Les facteurs qui permettraient que le projet dépasse ses objectifs ont-ils été considérés ?
- Les hypothèses ont-elles été comparées à des projets similaires menés hors de l’entreprise ?
- Les hypothèses ont-elles été comparées à des projets similaires menés au sein de l’entreprise ?
- Le processus de décision rassemble-t-il des personnes ayant une diversité de points de vue ?
- L’équipe qui doit prendre la décision a-t-elle été confrontée à des personnes qui ne sont, a priori, pas d’accord ?
- Au moins une solution alternative a-t-elle été envisagée ?
Selon le nombre de « oui » aux questions, quatre stratégies peuvent être envisagées : mener le projet, le suspendre, le reconsidérer ou le soumettre à un stress-test.
« Are you ready to decide ? », Par Philip Meissner, Olivier Sibony et Torsten Wulf, McKinsey Quarterly, 2015, volume 2.